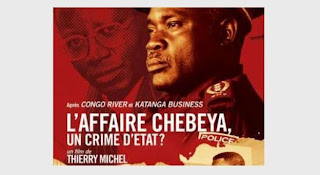« Français et langues nationales dans
les cinémas d’Afrique noire francophone :
De l’esthétisation du ressentiment à la
liquidation de la blessure »
Cinquante ans après l’acquisition
des indépendances, la problématique de la coexistence du français et des
langues nationales en Afrique de l’Ouest est loin d’être désuète. Même si de
nombreux observateurs s’accordent aujourd’hui à reconnaître que l’exclusion du
français des institutions scolaire et administrative de l’Afrique postcoloniale
n’est plus une thèse qui résiste à l’épreuve de la critique, force est de
reconnaître que les controverses relatives à la nature de la coexistence de ces
langues demeurent encore d’actualité et font toujours l’objet de chaudes
discussions. Comment faut-il ménager cette coexistence ? Quel statut
occupe-t-elle dans la pratique langagière quotidienne ? S’il n’est pas de
trop d’user de l’allégorie du mariage pour parler de cette problématique
linguistique, on pourrait se demander s’il s’agit de mariage à chambre séparée
ou de mariage tout court entre français et langues nationales.
Ce débat n’est pas seulement l’apanage des linguistes et des politiques.
Il est aussi l’objet d’une préoccupation dans la sphère de la création
artistique dont le rapport à la société est sans équivoque. Si l’art use de la
langue comme moyen d’expression, il ne peut être exempt des problématiques
linguistiques qui travaillent la société qui le génère. D’une manière ou d’une
autre, il en est informé. Il porte les marques du réel parce qu’il est une
modélisation du réel ; il est une mimesis, comme dirait Aristote. Ce
faisant, l’art modélise nécessairement la réalité linguistique de son contexte
d’élaboration. C’est cette fictionnalisation de la problématique de la
coexistence linguistique en Afrique de l’Ouest qui nous intéresse ici.
Autrement dit, quel est le régime de cohabitation linguistique en vogue
dans la création artistique africaine et notamment dans la cinématographie
d’Afrique noire francophone ? Comment les cinéastes africains francophones
réfractent-ils la problématique de la coexistence du français et des langues
nationales dans leurs œuvres ?
Il nous semble qu’une observation attentive de la dimension linguistique
des productions cinématographiques d’Afrique noire francophone, de 1955
à nos
jours, configure le rapport du français aux langues nationales suivant un
parcours qui va du ressentiment à la liquidation de la blessure. En d’autres
termes, le rapport du français aux langues nationales dans la cinématographie
d’Afrique noire francophone, du point de vue historique, a d’abord été
l’expression d’une vengeance contre la langue française par des détours
esthétiques avant d’aboutir à une intégration curative de la blessure
coloniale.
En effet, la volonté de reterritorialisation du cinéma en Afrique n’a pas
été sans le souvenir de la blessure ontologique causée par la colonisation et
le désir de se venger de la langue française considérée par le colonisé comme
étant le symbole de la présence continue du colonisateur. Ce désir de vengeance
a conduit à une sorte d’anthropophagie linguistique qui s’assortit à
l’anthropophagie culturelle dont parle Walter Moser, suivant les étapes de la
mise à mort, de l’incorporation, de l’assimilation et de la productivité
.
C’est sous ce rapport anthropophagique que nous analyserons le processus de
cinématisation de la
problématique linguistique en Afrique noire francophone.
I.
L’obstacle
linguistique du cinéma africain
Pour rendre compte de la prégnance du phénomène linguistique dans le cinéma
d’Afrique noire francophone, il convient tout d’abord de rappeler brièvement le
contexte d’émergence de ce cinéma et les missions premières qu’il s’est
assigné.
I. 1. Le cinéma africain : un cinéma subversif
Né dans le contexte des mouvements de protestation contre la domination
coloniale, le cinéma africain francophone est d’abord l’œuvre d’un groupe
d’intellectuels noirs. En 1955, Paulin Soumanou Vieyra et ses camarades
décidèrent, au bord de la Seine,
de mettre en image leurs dures conditions d’existence à Paris, en porte-à-faux
avec leur paisible enfance jadis en Afrique. Ce film, Afrique-sur-Seine - tourné en français - est ainsi considéré comme
le premier de l’Afrique noire francophone. Toutefois, le cinéma d’Afrique
francophone ne prendra véritablement son envol qu’à la faveur de l’avènement
des indépendances. Auparavant, selon le décret Laval de mars 1934, toute prise
de vue dans une colonie d’Afrique occidentale française devait être soumise à
l’autorisation du lieutenant gouverneur de ladite colonie. De toute évidence,
cette disposition coloniale ne permettait pas aux Africains d’exprimer
clairement leur point de vue au moyen de la caméra.
Ce n’est qu’en 1963 que Sembène Ousmane réalise Borom sarret, son premier court métrage. Borom sarret allait donner le ton d’un cinéma véritablement
africain, un cinéma de contestation contre les images du nègre sauvage, docile
et servile que véhiculait le cinéma colonial à des fins propagandistes pour
justifier la mission dite civilisatrice. Si dans Borom sarret, tout comme plus tard dans Le Mandat en 1978, Sembène Ousmane dénonce les fractures sociales
créées par l’entreprise coloniale en Afrique, l’exploitation de la classe
populaire par la classe dominante, dans La Noire de… réalisé en 1966, il s’érige contre
l’esclavage et l’aliénation de la dignité humaine.
Cette option idéologique de la dénonciation du pouvoir colonial et de ses
valets locaux, de la réhabilitation de
la dignité de l’Africain post-colonial et de la valorisation de sa culture,
sera le credo des cinéastes africains réunis au sein de la Fédération panafricaine
des cinéastes (FEPACI), créée en 1969. La FEPACI s’est en effet donné pour objectif
fondamental d’œuvrer à l’épanouissement de la pratique cinématographique en
Afrique, dans la perspective de la libération politique et culturelle du
continent par la démonopolisation des grands et petits écrans.
Dans cette perspective, on comprend aisément pourquoi le cinéma africain
francophone apparaît comme un cinéma subversif vis-à-vis du modèle occidental.
Il s’agit en effet de l’expression d’une vive conscience, celle de l’Africain
post-colonial déterminé à remettre en cause les stéréotypes coloniaux visant à
faire de l’homme noir un être inférieur. Ce combat des cinéastes africains
rencontrait de facto un obstacle linguistique. Dans quelle langue faut-il
tourner les films pour répondre aux aspirations de la FEPACI ?
I. 2. La problématique linguistique
Faire du français la langue du cinéma africain n’est-il pas une façon de
pérenniser la domination coloniale ? La réhabilitation de la culture
africaine ne passe-t-elle pas par la valorisation des langues africaines ?
Comment peut-on prôner la libération politique et culturelle de l’Afrique dans
une langue ignorée de la majorité des Africains ? Et pourtant, comment
ignorer aussi les exigences commerciales quand on sait que l’Afrique noire
francophone ne dispose d’aucune industrie cinématographique et que ses
productions filmiques dépendent largement des financements extérieurs ?
Tourner dans les langues africaines n’entraînerait-il pas la ghettoïsation et
l’asphyxie des films africains ? Les comédiens africains disposent-ils
tous de compétence linguistique en français pour assurer correctement leurs
rôles dans cette langue, si tant est qu’elle présente l’avantage d’élargir
l’audience du cinéma africain.
Ces différentes interrogations
révèlent à quel point le phénomène linguistique affecte le cinéma africain dans
sa double dimension artistique et commerciale. Opérer un choix apparaît comme
un dilemme tant la blessure de la colonisation est encore vivace dans les
esprits et les exigences commerciales, d’autant plus pressantes que le souci de
rentabilité et d’audience concurrence fortement l’idéal artistique.
Quel détour faut-il alors prendre pour concilier cette double exigence
idéologique et commerciale ? Il est évident que le rapport à la langue
française est perçu différemment selon les générations d’Africains au Sud du
Sahara. La façon dont les productions cinématographiques africaines des
premières heures, c’est-à-dire des indépendances aux années quatre-vingts,
réfractent cette problématique linguistique n’est assurément pas identique à la
perception actuelle des jeunes cinéastes qui évoluent dans une société où le
statut même du français en tant que langue étrangère est sujet à débat.
En effet, si les crises sociopolitiques qui ont secoué l’Afrique durant
les années quatre-vingts ont porté un coup aux idéaux panafricanistes qui
avaient cours à l’avènement des indépendances, elles ont aussi réorienté la
camera vers des problèmes beaucoup plus spécifiques aux différents Etats. On a
ainsi assisté progressivement à l’émergence des cinémas nationaux dont les
thématiques ne tarderont pas à étouffer les élans panafricanistes. De plus en
plus, la cinématisation du vécu
quotidien des peuples entraînera une modification du regard sur le français,
jusqu’alors perçu comme étant exclusivement la langue du colonisateur. Le
constat de l’immersion du français dans les habitudes langagières de nombreux
Africains, consécutive à la relative croissance des taux de scolarisation et au
brassage des ethnies du fait de la facilitation des moyens de transport et des
mariages interethniques, va naturellement modifier le rapport à cette langue et
déplacer la problématique linguistique du mode alternatif et exclusif vers des
horizons multilinguistiques où la coprésence de plusieurs langues repose plutôt
sur une relation de complémentarité. Alors que les cinéastes de la première génération
empruntaient des détours divers pour réaliser le meurtre symbolique de la
langue française, ceux de la nouvelle génération semblent s’approprier ce qui
paraissait un problème en procédant tout simplement à sa liquidation.
II.
De
l’esthétisation du ressentiment
En abandonnant la littérature pour le cinéma, Sembène Ousmane justifiait
son choix par l’efficacité expressive de l’image par rapport au mot. «
Le cinéma, dit-il, est un moyen de
communication plus efficace que la littérature, plus représentatif des modes
d’interaction des publics africains que ne peuvent l’être les textes
littéraires. Il permet de mettre en jeu à la fois les langues et formes
textuelles les plus fonctionnelles dans les sociétés africaines, permet de
valoriser plusieurs types d’espaces, d’expliciter leur signification et
d’offrir à un public jadis marginalisés
par la langue française d’innombrables occasions de se décrire et de s’observer
selon des critères qu’il aura lui-même définis »
.
Cet argumentaire, au-delà de la hiérarchisation axiologique qu’il établit
entre littérature et cinéma en tant que mode d’expression, est un procès de la
langue française dont le rôle de médiation est jugé non opérationnel dans le
contexte africain, et surtout, au regard des missions de sauvegarde et de
valorisation de la culture africaine que s’est assignées l’artiste. Du reste,
les propos que Sembène Ousmane prête, par ailleurs, au personnage de Niakoro
Cissé dans son roman
Les Bouts de bois de
Dieu n’expriment-ils pas assez clairement cette disgrâce du doyen des
cinéastes africains vis-à-vis de la langue française ? Dans la réprimande
qu’elle faisait à sa petite fille Ad’jibid’ji qui se rendait à
l’assemblée des hommes, la vieille Niakoro s’exclamait en ces termes :
«
Apprendre, apprendre quoi ?
(…) Je t’appelle, bon, il ne faut pas te déranger. Pourquoi, parce que tu
apprends le toubabou. A quoi ça sert le
toubabou pour une femme ? Une bonne mère n’en a que faire. Dans ma lignée
qui est aussi celle de ton père, personne ne parle le toubabou et personne n’en
est mort ! Depuis ma naissance – et Dieu sait qu’il y a longtemps – je
n’ai jamais entendu dire qu’un toubabou ait appris le bambara ou une autre
langue de ce pays. Mais vous autres, les déracinés, vous ne pensez qu’à ça. A
croire que notre langue est tombée en décadence ! » (P. 18.).
Ce passage traduit sans ambages l’aversion de la vieille Niakoro pour la
langue française. Mais que peut-elle contre cette langue ? A-t-elle
véritablement le pouvoir d’empêcher sa petite fille de parler le
français ? Ad’jibid’ji était inscrite à l’école du Blanc, et déjà,
elle lisait «
Mamadou et Bineta ». Il
nous semble que cette impuissance de Niakoro Cissé face au français est à
l’image de celle que manifeste le romancier-cinéaste.
Si le refus de parler le français au profit des langues africaines est,
de l’avis du romancier, une façon de mettre en
décadence ou plus exactement de « tuer » la langue du
colonisateur, alors le projet de Sembène Ousmane s’assortirait à une sorte
d’anthropophagie linguistique qui tire sa source du ressentiment colonial. Mais
la réalisation de ce projet est tout aussi impossible que la vieille Niakoro
est incapable d’arrêter l’élan de sa petite fille Ad’jibid’ji. Comme un phénix,
la mise à mort effective de la langue française paraît énigmatique, sinon
impossible. L’adoption du cinéma au détriment de la littérature est loin de
garantir la liquidation de la langue française en raison des exigences
commerciales que le septième art impose et compte tenu du danger de ghettoïsation
que pourrait encourir le cinéma africain tourné exclusivement dans des langues
africaines. En d’autres termes, l’abandon du chemin de la littérature au profit
des sentiers du cinéma n’est pas, dans la réalité, une solution aux
préoccupations anthropophagiques de l’artiste sénégalais. Ce choix consiste
plutôt en un détour artistique que Sembène Ousmane opère en vue de parvenir à
la réalisation symbolique de son meurtre linguistique, ce qui est synonyme de
revalorisation de sa culture bafouée. Il trouve dans le cinéma plus que dans la
littérature les stratégies appropriées à l’expression artistique de son
ressentiment et partant les moyens du retour à la condition première de sa
culture.
Il convient de rappeler que la notion de détour, qui est occurrente de
celle de retour, est une approche théorique élaborée par Edouard Glissant pour
rendre compte de la situation
antillaise, dans son ouvrage intitulé
Le Discours antillais. En appliquant cette démarche à l’examen de
la quête identitaire de l’Africain francophone, Joseph Paré indique que «
le détour accompagne cette obsession du
retour chez les peuples qui ont été transplantés ou qui ont vécu dans leur histoire l’impérialisme
culturel de l’occident. Le détour, poursuit-il, est la stratégie qui rend possible
le retour… » . Le
détour est alors une ruse artistique permettant d’effectuer un retour, qui
serait autrement impossible. Le retour à la situation précoloniale où le
toubabou n’exerçait aucune domination
sur les langues africaines étant pratiquement impossible, il faut alors
emprunter des détours pour parvenir au point où l’on était avant le coup de
force du colonisateur. C’est la transposition artistique de cette douloureuse
réalité dont on veut se venger que nous appelons l’esthétisation du ressentiment.
Et comme l’indique Dominique Château, l’esthétisation est «
une manière plus ou moins volontaire de
donner une teinture ou un sens esthétique à quelque chose qui ne l’a pas a
priori. »
Sembène Ousmane n’est sans doute pas
le seul cinéaste africain à user du détour pour rendre compte de son
ressentiment vis-à-vis de la langue française. D’autres cinéastes du continent
ont plus ou moins expérimenté des stratégies similaires dans le but de valoriser
les langues africaines et de renforcer l’ancrage culturel de leurs œuvres.
Parmi eux, on peut citer Souleymane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko, Gaston
Kaboré, Idrissa Ouédraogo, etc.
Il est à constater tout de même que
cette expression détournée du ressentiment vis-à-vis de la langue française, ou
le fait de revêtir son ressentiment d’une dimension esthétique en vue de lui
offrir un exutoire, se manifeste différemment d’un cinéaste à l’autre. Le
ressentiment peut varier d’intensité chez un même auteur, ou même se trouver
entièrement liquidé, c’est-à-dire épuré en fonction des périodes et des
thématiques abordées. Le rapport d’Idrissa Ouédraogo à la langue française dans
Yaaba, par exemple, n’est pas le même
que celui qu’il manifeste dans Cri de
cœur (2003). De même, Dani Kouyaté dans Kéità !
l’héritage du griot (1995) n’entretient pas le même type de rapport au
français que dans Ouaga Saga (2004).
On pourrait citer aussi Fanta Régina Nacro qui tourne Un certain matin (1992)
en mooré et La Nuit de
la vérité (2004) en français. C’est dire, par ailleurs, que la
périodisation que nous avons établie en termes de génération n’a qu’une valeur
indicative, de même que l’appartenance d’un cinéaste à telle ou telle période
de l’histoire cinématographique n’est guère figée.
De manière générale, l’esthétisation
du ressentiment des cinéastes africains vis-à-vis de la langue française
s’opère par des détours variés dont les stratégies fondamentales sont la
titraison, le sous-titrage et la voix off.
II.1. La titraison
Le titre d’un film est l’élément déterminant de son identité. Il
constitue son nom propre et cristallise, de ce fait même, la charge sémantique
du film. Le titre est à la fois une annonce, une évocation, un renvoi, mais
aussi un horizon d’attente. A l’image du prénom humain qui, dans la plupart des
cas en Afrique, est porteur d’un souvenir, d’un programme ou tout simplement
d’un idéal – celui du donateur du prénom – le titre d’un film est aussi porteur
d’un projet cinématographique et constitue une médiation entre la vision
intérieure de l’artiste et les manifestations figurative et plastique générées
par cette vision.
Ce faisant, la titraison que nous concevons comme étant le processus qui
consiste à donner un titre à une œuvre revêt une importance qui va bien au-delà
d’un simple marketing mercantiliste. La titraison, c’est la façon de donner
forme à ce qui est informe ou supposé tel. Au-delà de sa valeur dénominative,
elle a une charge identitaire. Elle découle d’un projet et elle est grosse d’un
sémantisme dont les isotopies fondamentales peuvent être lexicalisées en termes
de suggestion, de promesse ou d’orientation de lecture.
Sous ce rapport, il nous semble qu’une observation attentive de la
titraison des films africains laisse apparaître une certaine récurrence des
formulations de titres en langues nationales africaines qui frise une attitude
obsessionnelle.
Outre les éponymes comme « Niaye » (1964) de Sembène Ousmane,
« Wend kuuni » (1982) de Gaston Kaboré, « Poko » (1981) et
« Yaaba » (1989) d’Idrissa
Ouédraogo, qui sont tout aussi lourds de sens en tant que prénom, il y a une
véritable conceptualisation du titre dans les langues nationales qui confère,
pour le moins, aux différents films une coloration locale. Ainsi peut-on citer
entre autres :
De Sembène Ousmane les titres comme :
-
Borom Sarret
(1963)
-
Xala (1974)
-
Ceddo (1977)
De Souleymane Cissé
-
Baara (1978)
-
Finyè (1983)
-
Yeelen (1987)
-
Waati (1995)
De Djibril Mambéty Diop
-
Touki Bouki
(1973)
De Sanou Kollo
-
Paweogo
(1983)
De Cheikh Oumar Sissoko
-
Nyamanton
(1986)
De Idrissa Ouédraogo
-
Yam daabo
(1986)
-
Tilaï (1990)
-
A Karim na Sala
(1991)
De Gaston Kaboré
-
Buud Yam
(1997)
De Adama Drabo
-
Taafe fanga
(1997)
De Saint Pierre Yameogo
-
Simandé
(1998)
Et la liste
n’est pas exhaustive.
Une telle récurrence des titres en
langues nationales, même dans le cas où le film est tourné en français comme
Paweogo, ne saurait relever d’un simple
effet de mode. Au-delà de la volonté de reterritorialisation du projet
cinématographique par les Africains
, il
s’agit de façon détournée de baptiser l’œuvre filmique d’un nom porteur d’un
projet identitaire qui conditionne son existence. La pratique cinématographique
se positionne dès lors comme le lieu d’une épiphanie identitaire. Dans cette
perspective, on comprend aisément que la titraison des films africains en
langues nationales ne relève pas uniquement d’un besoin de coloration locale.
Elle est symptomatique d’un désir obsessionnel, celui de la de manifestation de
soi. Ce désir est sensé trouver son assouvissement, dès l’entame, du film par
le biais de la titraison.
II.2. Le sous-titrage
Outre la titraison, l’esthétisation du ressentiment des cinéastes
africains s’opère par le détour du sous-titrage. Le sous-titrage consiste en la
surimpression de texte au bas de l’image, dans l’intention de traduire, le plus
souvent dans une autre langue, le dialogue des personnages filmiques. Cette
traduction synchrone avec le dialogue, au bas de l’écran, vise à rendre le film
accessible à un public qui ne comprendrait pas la langue de tournage du film.
A l’avènement du cinéma parlant, le sous-titrage était perçu comme une
sorte de résumé du dialogue des personnages dans le but de fournir à un public
étranger, juste des éléments d’information essentiels à la compréhension de
certains aspects du film. On se fiait à l’universalité du langage iconique
sensé traduire de façon satisfaisante le contenu filmique.
De nos jours, la pratique du sous-titrage ne consiste plus en
l’inscription des éléments supposés indispensables à la compréhension du film.
Elle tend à être une traduction fidèle du dialogue, de sorte à rendre compte
des subtilités de la langue. Si cette quête de fidélité dans la traduction
présente l’avantage d’installer le spectateur dans l’illusion de ne rien perdre
du contenu filmique, il reste malheureusement (et c’est le cas hélas fréquent
dans la filmographie africaine) que cette manière de procéder n’est pas sans
courir le risque de tomber dans la littéralité, et partant, dans la
massification de tracés graphiques dont le défilement rapide ne permet pas une
lecture intelligible du message. Force est de constater, par ailleurs, qu’en
matière de sous-titrage dans les productions cinématographiques africaines, il
se pose, le plus souvent, de sérieuses difficultés de compétence linguistique
qui en ajoutent à l’inintelligibilité du message.
Quelle que soit la technique utilisée, le sous-titrage induit une
hiérarchisation des langues en présence, et c’est à ce niveau que réside la
dimension stratégique de cette pratique que nous concevons comme un détour
artistique permettant l’expression d’un ressentiment linguistique.
En effet, en faisant des langues africaines la langue de tournage de
films africains, les cinéastes s’inscrivent résolument dans le projet panafricaniste
de la valorisation des cultures africaines dont la langue constitue le véhicule
principal. Il se trouve qu’une telle option comporte inéluctablement le risque
de confiner la production cinématographique dans une aire culturelle qui ne
favorise pas son épanouissement commercial. Pour échapper à ce risque de
ghettoïsation, le sous-titrage apparaît comme une stratégie qui offre
l’avantage d’assouvir un besoin d’expression identitaire tout en satisfaisant
aux exigences commerciales.
Mais on pourrait se poser la question de savoir pourquoi pas
l’inverse ? Si tant est que la langue française dispose d’une audience
plus importante que les langues nationales, pourquoi ne pas tourner les films
en français et les sous-titrer dans les langues nationales ? Pour répondre
à cette interrogation, il faut se garder de tirer précipitamment argument de
l’analphabétisme des locuteurs africains en langues nationales ou de
l’incompétence supposée de certains comédiens à parler couramment le français.
Il nous semble qu’au-delà de toutes ces raisons apparentes, le tournage des
films en langues nationales et leur sous-titrage en français repose sur un
choix idéologique opéré en vertu d’une considération axiologique. En reléguant
la langue française au bas de l’écran, en inondant en revanche la quasi
totalité de l’écran des langues nationales, il apparaît au plan même de
l’occupation de l’espace filmique une discrimination notoire en faveur des
parlers africains.
Quand on sait les difficultés qu’éprouve le spectateur à partager
constamment son regard entre les images projetées au cœur de l’écran et le
sous-titrage confiné sur le bord inférieur de l’écran, on est en droit de se
demander si la démarche stratégique du sous-titrage, en dépit des raisons
commerciales qu’on pourrait évoquer, ne cache pas une volonté d’incrimination
de la langue française.
En tout état de cause, au-delà de la discrimination spatiale consistant
au rejet du français au bas de l’écran, l’esthétisation du ressentiment par le
biais du sous-titrage semble se confirmer par un constat d’émasculation de la
langue du colonisateur qui se trouve être réduite à un mutisme graphique. En
effet, le sous-titrage, faut-il le rappeler, est l’inscription graphique d’une
langue dans un univers cinématographique où une autre langue se déploie
pleinement dans toutes ses sonorités en tant que parole réellement proférée par
les personnages du film. La langue du sous-titrage confinée au mutisme
s’opposerait ainsi à celle du tournage, caractérisée par sa vitalité orale. En
vidant de la sorte la langue du sous-titrage du son qui constitue l’épaisseur de
toute langue, en l’extrayant de la bouche qui lui confère sa vitalité, on la
soumet à une mutilation qui s’assortit à un processus de castration dont la
symbolique est fortement représentative d’un désir fantasmatique de vengeance.
Dans le même ordre d’idée, la voix off, telle que cela se manifeste dans La Noire de…de Sembène Ousmane, résulte d’un
processus d’esthétisation du ressentiment du doyen des cinéastes africains
vis-à-vis de la langue française.
II.3. La voix off
L’avènement du parlant a
véritablement révolutionné la pratique cinématographique. Il ne s’est pas agi
d’une simple addition du son à l’image pour accroître l’expressivité de
celle-ci. La révolution du parlant a
induit une refondation de l’esthétique cinématographique aussi bien au plan de
la conduite du récit filmique qu’au plan des rapports entre l’image, l’écran et
le son. En rehaussant l’impression de réalité du septième art, le bruit, la
musique et surtout le verbal ont, par leur fonctionnalité narrative, donné du
relief aux jeux des acteurs, accrû le pouvoir énonciatif du cinéma et amplifié
sa capacité évocatrice. Le verbal notamment a introduit au cœur de la pratique
cinématographique la problématique de la voix humaine dont les implications
esthétiques sont considérables.
Objet sonore primordial du cinéma, la voix humaine constitue un attribut
essentiel du personnage. En plus de sa valeur sémantique, elle est «
source de profondes résonances affectives
(…) en raison de son fort coefficient d’humanité »
. Son
exploitation au cinéma est assez diversifiée.
Elle est dite acoustique lorsque la source émettrice est visible à
l’écran. C’est ce que l’on appelle, par ailleurs, la voix in. C’est celle du personnage filmique que l’on voit dans le cadre
et qui s’exprime.
La voix est acousmatique lorsqu’on ne perçoit pas sa source de provenance
à l’écran. Dans ce cas de figure, trois types de rapport avec le champ iconique
sont possibles. La voix peut être qualifiée de « hors-vu »,
c’est-à-dire que la source est dans le champ, mais cachée par un élément
quelconque du décor. Elle est qualifiée de « hors-champ » lorsque la
source émettrice n’est pas du tout perceptible à l’écran mais fait partie de
l’histoire racontée. La voix acousmatique est dite « hors cadre » ou
plus précisément « voix off » lorsqu’elle provient d’une source
extérieure à l’espace et à l’histoire racontée dans le champ iconique.
Du point de vue de l’histoire racontée, il apparaît que les « voix in »,
« hors-vu » et « hors-champ » relèvent de l’univers
diégétique du film, tandis que la « voix off » relève de l’univers
extradiégétique et la plupart du temps, elle est celle du narrateur extérieur à
l’histoire, qui commente les faits et gestes d’un personnage, avec parfois le
pouvoir de révéler même la pensée intérieure de celui-ci. Un tel récit est en
focalisation interne fixe à l’exemple de ce qui se passe dans La Noire de…, lorsque le narrateur, extérieur à
l’histoire et au cadre, raconte la pensée de Diouana en français.
Cette option narrative opérée par Sembène Ousmane pour rendre compte du
point de vue de son personnage principal, surtout lorsque ce dernier était en
France, à Antibes, comporte des enjeux esthétiques certains qui s’assortissent
à un détour artistique rendant possible l’expression d’un ressentiment.
Rappelons que La Noire de… est l’histoire d’une jeune fille
sénégalaise, Diouana, une « bonne », c’est-à-dire une servante de
maison, qui accepte avec enthousiasme la proposition de ses patrons blancs, qui
retournent chez eux en France, de les y accompagner pour travailler. Le plaisir
de la découverte de ce nouveau monde se transforme très vite en une profonde
déconvenue. Diouana se sent esclave de sa patronne qui n’a aucune considération
pour elle. Emmurée entre la chambre, la cuisine et la salle à manger, isolée, méprisée,
commise à toutes les tâches domestiques, Diouana ne supporte pas la négation de
sa personnalité. Elle décide de se suicider dans la salle de bain de ses
patrons.
De toute évidence, le choix de la voix off pour rendre compte du point de
vue de Diouana dans cet univers carcéral est une stratégie narrative qui
accentue la déshumanisation du personnage. En lui ôtant la parole de la bouche
au profit d’un narrateur extérieur qui exprime en ses lieu et place sa pensée,
c’est une façon de rendre plus prégnante l’anéantissement de la personnalité de
Diouana. Elle devient tout aussi muette que le masque accroché dans le salon de
ses maîtres. Ce mutisme est fortement symbolique de la chosification dont elle
est victime, et dont elle décide de se libérer en se donnant la mort.
Mais au-delà de ce sémantisme de la voix off, il est possible d’y voir
une autre signification si on considère l’usage de cette technique narrative
sous l’angle de la dynamique linguistique. Il nous semble qu’au cinéma, l’image
et la voix entretiennent d’étroites relations à tel point que leur influence
est réciproquement ressentie. En effet, de même que la pratique de la voix off
amoindrit la dimension humaine d’un personnage dont on dit l’histoire, de même
elle affaiblit la vitalité de la langue dont on use. La voix off, comme nous
l’avons précédemment indiqué, est en dehors du cadre diégétique. Elle est en
retrait par rapport au monde fictif que crée le film. Ce retrait qui pourrait
s’assimiler à un rejet n’est pas exempt de connotation dysphorique. La voix off
ne fait pas partie de la dynamique interne des échanges verbaux dans le récit
filmique. Ce faisant, elle ne bénéficie pas des inflexions diverses qui donnent
vie à la langue en situation de communication. Elle devient une sorte de langue
passive, monocorde, à la limite érodée et sans empreinte particulière.
Lorsqu’une voix est portée par une image visible, elle rentre dans la
plénitude de ses fonctions informatives et identificatrices. Outre sa dimension
sémantique, elle devient l’attribut essentiel du personnage qui la porte, et se
trouve affectée à son tour par la personnalité de celui dont elle est
l’attribut. En revanche, quand elle fonctionne comme un son qui se laisse tout
simplement entendre dans la nature, elle se trouve vidée de la substance de son
actualité par rapport au récit, et partant, de sa vitalité. De même que la voix
porte en elle le pouvoir de fantasmer la bouche en tant que lieu d’émission de
la parole, de même la bouche qui profère a un pouvoir d’irradiation de la voix
et de personnalisation de la parole.
Au regard donc de ce qui précède, il apparaît que l’usage de la voix off
dans La Noire
de…relève d’un détour artistique visant à trouver un exutoire à un
ressentiment colonial. Il s’agit d’une stratégie narrative qui participe de la
volonté du cinéaste de commettre symboliquement le meurtre de la langue
française. En choisissant la voix off en français, Sembène Ousmane procède à
l’exclusion de cette langue de son univers filmique, du moins en ce qui
concerne la séquence relative à la vie de Diouana en France. Cela s’apparente à
une sorte de séquestration du français à l’image de la vie d’esclave imposée à
Diouana. On pourrait même affirmer que le refus de la jeune fille de se laisser
domestiquer par ses patrons est symétrique à son refus volontaire ou
involontaire de parler le français. Par le même biais, le cinéaste réalise
symboliquement son meurtre, dans la mesure où il réussit à émasculer cette
langue, en ne la faisant pas portée par une image visible.
C’est dire de manière générale que l’impossibilité de se défaire de la
langue française, en dépit du ressentiment qu’éprouvent de nombreux cinéastes
africains francophones de la première génération à son égard, trouve une
résolution à travers des détours esthétiques dont l’intentionnalité est de
procéder à la mise à mort symbolique de cette langue considérée comme étant le
prolongement de la domination coloniale. C’est cette obligatoire coexistence
que nous représentons sous l’allégorie du mariage à chambre séparée.
Cependant, l’examen de la dimension linguistique des productions
cinématographiques actuelles appelle un autre constat. Il nous semble que ces
productions filmiques consacrent la liquidation de la blessure coloniale et
entretiennent un nouveau rapport à la langue française.
III.
De la
liquidation de la blessure coloniale
Les productions cinématographiques récentes, contrairement à celles de la
première génération, ne réfractent pas la problématique de la coexistence du
français et des langues nationales sous le mode d’un désir de vengeance qui
trouverait son assouvissement dans un détour esthétique. L’artistisation de la
pratique linguistique dans la filmographie moderne offre plutôt le constat
d’une liquidation de la blessure coloniale, par le fait de l’assimilation et de
l’appropriation de la langue du colonisateur par le colonisé.
En d’autres termes, le ressentiment fait place à une sorte
d’accommodation de l’être du colonisé à la blessure ontologique infligée par le
colonisateur. Cette accommodation appelle un nouveau rapport à la langue
française qui se trouve, dorénavant, intégrée dans un circuit de communication
où elle acquiert un statut autre que celui de langue étrangère. Elle subit un
processus d’indigénisation, ou plus exactement d’incorporation curative qui
émousse son étrangeté et lui confère une couleur locale. Ce faisant,
l’agression et la mise à mort symbolique dont le français était victime dans
les productions cinématographiques de la première génération cessent au profit
d’un nouveau regard qui ne le perçoit plus comme un élément exogène au service
de la domination coloniale, mais plutôt, comme un médium de communication
appréhendé dans une dynamique de productivité. Ce qui était autrefois considéré
comme un obstacle linguistique se transforme en une opportunité linguistique.
Du cri pathétique de Mongo Béti : « Seigneur, délivre-nous de la
francophonie… »
, on
est passé aux préceptes paternalistes de Guy Ossito Midiohouan : « Du
bon usage de la francophonie »
.
III.1. Du mythe babélique au mythe
pentecôtiste de la chambre haute
Le passage de l’étape du ressentiment vis-à-vis de la langue française à
celui de son incorporation productive dans le discours filmique africain
présente quelques traits de ressemblance avec l’histoire biblique de la tour de
Babel
, et
surtout, avec celle de l’événement linguistique produit à la pentecôte au
moment où les disciples étaient réunis dans la chambre haute
. La
difficulté de bâtir une tour – linguistique – sur la base d’une seule langue,
celle de la culture du cinéaste, dont l’expression totale passe par la mise à
mort impossible de la langue du colonisateur, semble avoir conduit à une
dispersion linguistique dont les productions cinématographiques récentes se
font l’écho.
Toutefois, il convient plus de parler de polyphonie linguistique dans la
cinématographie ouest africaine francophone que de dispersion linguistique. Ce
qui se passe dans cette nouvelle filmographie se démarque en effet de
l’incompréhension qui caractérise les acteurs de la tour de Babel. La
polyphonie linguistique, dans les récentes productions cinématographiques
africaines francophones, partage avec le mythe pentecôtiste l’étonnement du
spectateur et l’intercompréhension entre les acteurs. Cependant, à la
différence du récit biblique de la pentecôte où les locuteurs se sont mis à
parler dans des langues qu’ils sont censés ignorer, la cinématisation actuelle de la pratique linguistique met en scène
des auditeurs qui comprennent des langues qu’ils sont supposés ignorer. En
d’autres termes, on assiste dans un même univers diégétique à une mosaïque de
parlers qui s’assortit, dans une certaine mesure, au mythe pentecôtiste de la
chambre haute.
La liberté ainsi accordée à chaque personnage filmique de s’adresser à
son interlocuteur, dans la langue de sa convenance et dans une même situation
de communication, apparaît à cet égard comme une richesse linguistique.
On peut citer en guise d’exemple le film de Boubacar Zida dit Sidnaba, Un fantôme dans la ville (2008), tout
comme les films feuilletons, Ma famille
d’Akissi Delta (2004), ou encore Cour
commune d’Adama Rouamba dit Adama le Phénix, réalisé en 2010. Dans ces productions
cinématographiques, des langues nationales telles que le moré, le dioula le
bété font parfois irruption dans le discours filmique majoritairement tenu en
français. De toute évidence, ce cas de figure n’est pas seulement
caractéristique des productions africaines.
Par contre, il nous semble que les films de Boubacar Diallo réfractent de
façon particulière cette polyphonie linguistique avec une intentionnalité tout
aussi particulière. La plupart de ses films apparaissent comme le lieu d’une
coexistence féconde ou d’un mariage tout court entre le français et les langues
nationales. Que ce soit dans Mogo-Puissant
en 2007, Charly et Omar en 2010, Julie et Roméo en 2011, l’univers
filmique d’Aboubacar Diallo est marqué par un pluricodisme où des personnages
communiquent avec des codes différents dans un même espace diégétique.
Le titre Mogo-Puissant, par
exemple, est en lui-même illustratif de cette dynamique productive de la
coexistence du français et des langues nationales. Ce mot composé est constitué
de deux lexèmes issus de deux codes linguistiques différents, qui fonctionnent
pourtant comme une unité monématique. Mogo-Puissant est en effet un mot hybride
qui tient sa substance constitutive du dioula, langue nationale et du français
langue étrangère « nationalisée ».
Cette nouvelle dynamique productive qui se manifeste par un
investissement pluricodique de l’univers filmique soulève des enjeux
identitaires caractéristiques de l’espace ouest africain francophone. Sans être
une entrave à l’intercompréhension, la coexistence du français et des langues
nationales sous le mode de la polyphonie linguistique détermine, non seulement,
le statut aphone de nombreux Africains francophones, mais aussi l’identité
polymorphe de l’Africain francophone postcolonial.
III.2. Les enjeux identitaires de
la polyphonie linguistique dans l’espace filmique
Le constat de la liquidation de la blessure coloniale au plan
linguistique, rendue possible grâce à un processus d’incorporation curative du
français dans les habitus langagiers des Africains francophones, révèle un double enjeu identitaire. La révélation du
statut aphone de nombreux Africains francophones d’une part, et d’autre part,
la mise en exergue de l’identité polymorphe de l’Africain francophone
postcolonial.
III.2.1. La révélation du statut
aphone des Africains francophones
La capacité de certains personnages filmiques de comprendre leurs
interlocuteurs qui s’expriment en français, de converser avec eux en répliquant
dans une des langues nationales, relève moins d’un choix opéré dans une gamme
de codes à leur disposition que d’une contrainte objective. Cela se justifie
d’autant plus que dans l’imaginaire collectif de nombreux Africains
francophones, parler français est un signe indicatif du statut social du
locuteur, un signe d’appartenance à une classe sociale supérieure à celle de
ceux qui ne sont pas locuteurs de cette
langue.
Dans ce contexte, il apparaît clairement que le fait de ne pas s’exprimer
en français dans une situation de communication qui l’exige témoigne d’un
handicap linguistique qui dénote la faible considération du statut social du
personnage. En revanche, lorsqu’un locuteur choisit de parler français au
détriment de la langue nationale parlée par son interlocuteur, et dans laquelle
il est supposé s’exprimer, il opère, le plus souvent par ce biais, un jugement
de valeur dont l’objectif est d’afficher son appartenance à une classe sociale
supérieure.
Au-delà de cette première configuration des sujets parlants dans la
filmographie ouest africaine francophone où le français est indicatif du statut
social des personnages, ce qui présente par ailleurs un intérêt
cinématographique certain quant à l’impression de réalité que cela confère au
jeu des acteurs, il apparaît de cette polyphonie linguistique une autre configuration
du sujet filmique qui repose cette fois-ci sur un nouveau rapport au français
et à la francophonie.
En réalité, si des locuteurs sont capables de converser dans des codes
différents, notamment en français et en langues nationales dans le même espace
diégétique, cela implique qu’on affaire à une sorte négation de certains
attributs du français. Il ne suscite plus de complexe d’infériorité ni de
supériorité et se trouve par conséquent réduit à sa stricte dimension
communicationnelle. Il entre dans un régime de coexistence équilibrée avec les
langues nationales et partage avec celles-ci le même espace.
Mais au-delà de ce nouveau régime de coexistence, un autre constat
s’impose. L’enjeu majeur de la polyphonie linguistique dans l’univers filmique
ouest africain réside dans la révélation du statut aphone de nombreux Africains
francophones. Autrement dit, il s’agit de la mise en scène cinématographique de
sujets qui comprennent le français mais qui sont incapables de le parler et
encore moins de l’écrire. Cette situation dans laquelle se trouvent de nombreux
Africains francophones pose le problème même de leur appartenance à la
francophonie.
En effet quand on considère qu’il y a moins de quarante pour cent de
Burkinabè, par exemple, qui savent
converser en français – ce qui ne représente pas le pourcentage le plus
bas de la région ouest africaine francophone – cela induit que l’appartenance
francophone des pays d’Afrique de l’ouest repose plus sur d’autres critères que
le critère linguistique. Il s’agit davantage d’une francophonie géographique,
institutionnelle que langagière.
Il nous semble que c’est cet enjeu identitaire qui sous-tend la
cinématisation de la pratique linguistique dans les récentes productions
filmiques africaines. Elle révèle des sujets africains francophones qu’il
conviendrait de qualifier d’Africains francophones aphones.
III. 2.2. La révélation d’une identité polymorphe
L’investissement pluricodique de l’espace filmique dans les récentes
productions cinématographiques africaines comporte des enjeux identitaires qui
vont au-delà d’une simple considération linguistique. En établissant l’analogie
entre le passage du ressentiment à la liquidation de la blessure et, le passage
du mythe babélique au mythe pentecôtiste, il s’agissait de mettre en exergue le
passage de la volonté de célébration d’une langue et donc d’une culture, à la
nécessité de célébration de plusieurs langues, donc de plusieurs cultures.
On est ainsi passé de la magnificence d’une culture babélique à la
célébration d’une polyphonie linguistique qui apparaît plus conforme à l’être
de l’Africain postcolonial. L’identité archéologique babélique semble être, pour
le moins, inaccessible, sinon, à jamais perdue. L’Africain postcolonial est
davantage un être hybride polyphone, à l’image de ce que réfractent les
récentes productions cinématographiques. Il est un être composé à l’instar du
mot composé « Mogo-Puissant » et fonctionne comme une entité hybride
tout comme l’unité monématique « Mogo-Puissant ».
C’est cette identité hybride en perpétuelle construction qu’il convient
d’appeler une identité polymorphe au regard du caractère protéiforme de ces
constituants. Elle s’oppose à l’identité archéologique monophone et monoforme
qui n’existe que dans l’imaginaire. La réalité de l’Africain francophone
postcolonial, telle que cela apparaît de plus en plus dans la création
cinématographique de cette partie du continent, est celle de l’impossible
retour aux sources, de l’impossible meurtre de la langue française. C’est une
réalité marquée par la polyphonie linguistique de chaque sujet parlant, ce qui
est éloquemment illustratif d’une identité polymorphe.
Pour conclure
La coexistence du français et des langues nationales en Afrique de
l’ouest pose une problématique qui n’est pas étrangère à la création
artistique. Dès lors que les Africains francophones se sont saisis de la
camera, ils ont été confrontés à cette question de la coexistence entre la
langue du colonisateur et leurs langues nationales. Dans l’impossibilité de se
débarrasser du français, tout comme ils se sont libérés de la domination
coloniale, ils ont user de détours esthétiques divers pour commettre le meurtre
symbolique d’une langue naguère considérer comme étant le prolongement de
l’occupation territoriale.
Ce vif ressentiment vis-à-vis de la langue française, suscité par le
souvenir de la domination coloniale, sera liquidée au fil du temps grâce à de
nombreux facteurs ayant permis l’accommodation du sujet africain postcolonial à
la blessure. C’est ce que réfractent les récentes productions
cinématographiques à travers l’option d’une polyphonie linguistique qui envahit
l’univers filmique. Cette option soulève évidemment des enjeux identitaires qui
mettent en lumière le statut aphone de nombreux Africains francophones et leur
identité polymorphe. Elle relance le débat du rapport des Africains à la
francophonie et suscite des interrogations quant à l’avenir des langues
nationales dans un contexte où des a-francophones évoluent assez rapidement
vers le statut de francophones aphones. C’est à se demander le sort qui sera
réservé aux langues nationales quand on sera véritablement francophone.
Justin OUORO
Université de Ouagadougou
Bibliographie
CHATEAU,
Dominique, Esthétique du cinéma,
Armand Colin, 2006.
GARDIES, André
et BESSALEL, Jean, 200 mots-clés de la
théorie du cinéma. Paris :
éditions du CERF,
1992.
MOSER, Walter
« L’anthropophagie du sud au nord », in Confluences littéraires, dir.
Peterson M. et
Bernd Z. 1992.
NIANG, Sada,
(dir.), Littérature et cinéma en Afrique
francophone : Ousmane Sembène et
Assia Djebar,
L’Harmattan, 1996.
OUORO, Justin, Poétique des cinémas d’Afrique noire
francophone, Presses universitaires de
Ouagadougou,
2011.
PARE, Joseph,
« Africain francophone : les détours d’une identité
paradoxale »,
Communication donnée
à l’occasion du colloque sur le thème : Francophonie
plurielle. Paris,
17-20 mai 2001.